Reproduction sexuée
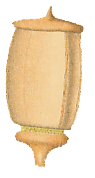
Reproduction&dispersion
La reproduction sexuée implique le mélange de gènes de deux parents différents pour donner une progéniture avec une composition génétique similaire à, mais différente de, chaque parent. Chez les bryophytes, le processus nécessite la production de gamètes mâles (spermatozoïdes), de gamètes femelles (ovules) et de certains moyens d’amener le sperme dans les ovules. Les gamètes sont produits sur les gamétophytes. Les spermatozoïdes sont produits dans des structures minuscules, généralement en forme de massue, appelées anthéridies et vous pouvez également voir des spermatozoïdes bryophytes appelés anthérozoïdes. La tige ancre l’anthéridium au gamétophyte. Chaque anthéridium produit de nombreux spermatozoïdes. Les œufs sont produits dans des structures minuscules, généralement en forme de fiole, appelées archégonie. Chaque archégonium contient un ovule (dans une section enflée appelée venter) et les spermatozoïdes entrent par le canal dans la section tubulaire (ou cou) plus étroite. Du côté du ventre opposé au cou se trouve le pied qui ancre l’archégonium au gamétophyte. Dans les premiers stades du développement archégonial, ce canal n’existe pas, la zone étant remplie de cellules. À maturité, les cellules au centre du cou se désintègrent pour créer le canal. Le canal est rempli de mucilage résultant de la décomposition des cellules qui occupaient initialement le canal.
Un ovule fécondé dans un archégonium se développe en sporophyte. Le sporophyte est constitué d’une capsule contenant des spores qui, selon les espèces, peut être traquée ou sans tige. Chaque spore contient un mélange de gènes des deux parents et une germination réussie donnera naissance à un nouveau gamétophyte.
Les diagrammes suivants montrent quelques archégones et anthéridies de mousse. Les figures ont été copiées du livre The Vegetable Kingdom de John Lindley, publié en 1853. Les archégones sont à gauche et ont été colorées en vert, vous pouvez voir les venters gonflés près des bases archégoniales. Au sommet du cou, chaque archégonium a une bouche en forme d’entonnoir. Les anthéridies sont à droite, sont colorées en bleu et l’anthéridium du milieu libère une masse de spermatozoïdes, de couleur brun-orangé. L’archégonie et l’anthéridie se mêlent à des paraphyses ressemblant à des cheveux ou à des massues, laissées non colorées dans les diagrammes. Le paragraphe précédent mentionnait que les anthéridies et les archégones sont minuscules. La taille varie selon les espèces, mais généralement, ces organes producteurs de gamètes mesurent bien moins d’un millimètre de longueur.
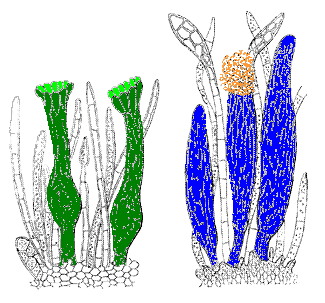
Les anthéridies bryophytes ont une structure assez uniforme et il en va de même pour l’archégonie. Les anthéridies varient en taille et en forme (de globuleux à quelque peu cylindriques) selon les espèces, mais le diagramme ci-dessus capture l’essence de tout anthéridium – une tige courte et étroite supportant un organe gonflé produisant du sperme. De même, l’archégonie varie en taille et en longueur relative du cou, du ventre et de la longueur du pied porteur – mais le diagramme ci-dessus montre les caractéristiques essentielles de toute archégonie.
Les anthéridies et les archégones individuelles sont microscopiques, mais on peut parfois voir où elles se forment. Sur cette photo ![]() de la mousse Rosulabryum billardieri chaque boule jaune est un groupe d’anthéridies. Il en est de même sur cette photo
de la mousse Rosulabryum billardieri chaque boule jaune est un groupe d’anthéridies. Il en est de même sur cette photo ![]() d’une hépatique thallose du genre Fossombronia. Cette photo
d’une hépatique thallose du genre Fossombronia. Cette photo ![]() montre des plantes mâles de l’agripaume Phaeoceros inflatus et des anthéridies sont produites dans les nombreuses « cloques » visibles sur le thalle. Des groupes d’archégones se trouvent sous les « cloques » blanches montrées sur cette photo
montre des plantes mâles de l’agripaume Phaeoceros inflatus et des anthéridies sont produites dans les nombreuses « cloques » visibles sur le thalle. Des groupes d’archégones se trouvent sous les « cloques » blanches montrées sur cette photo ![]() de l’hépatique thallose Lunularia cruciata.
de l’hépatique thallose Lunularia cruciata.
Bien qu’il y ait beaucoup d’uniformité au niveau structurel, il y a une variété dans la formation et la disposition de l’archégonie et des anthéridies. Le reste de cette page donnera un aperçu du cycle de reproduction sexuée ![]() .
.
Amener le sperme à l’ovule
Une fois qu’un anthéridium a mûri et contient des spermatozoïdes viables, les spermatozoïdes doivent atteindre les ovules en archégonie. La première étape pour que le sperme sorte des anthéridies et la seconde consiste à se rendre ensuite dans l’archégonie et à féconder les œufs à l’intérieur. L’eau est essentielle pour les deux étapes.
Chez certaines bryophytes, un anthéridium mature retiendra des spermatozoïdes libres, mais ce n’est généralement pas le cas, mais chaque spermatozoïde est toujours maintenu dans la cellule dans laquelle il s’est formé. Dans un tel cas, lorsqu’un anthéridium s’ouvre, ces cellules contenant des spermatozoïdes sont libérées et ce n’est qu’à un certain stade après la libération de l’anthéridium que le sperme unique, à l’intérieur de chacune de ces cellules, est libéré. Cette libération peut avoir lieu peu de temps après l’ouverture de l’anthéridium ou jusqu’à 15 minutes plus tard, selon les espèces. Dans ce qui suit, l’expression « masse de spermatozoïdes » désignera soit une masse de spermatozoïdes libres, soit une masse de cellules contenant des spermatozoïdes, lorsqu’il n’est pas essentiel de distinguer les deux.
Lorsqu’un anthéridium mature est humidifié, les cellules à l’apex absorbent l’eau, gonflent et finissent par éclater ou s’ouvrir d’une manière ou d’une autre. La masse de sperme à l’intérieur d’un anthéridium mature est sous pression. Ainsi, une fois qu’un anthéridium s’est ouvert, la masse de sperme est expulsée. Chez certains bryophytes, la force est suffisante pour tirer la masse de sperme dans l’air, permettant la dispersion sur une zone relativement large. Cependant, dans la plupart des cas, la masse de sperme suinte simplement dans la zone autour de l’anthéridium et la dispersion se fait par d’autres moyens. Alors que la masse entière du sperme peut parfois être libérée lors de l’extrusion forcée, la libération est plus souvent un processus en deux étapes. Généralement, un pourcentage important de la masse des spores est rapidement expulsé par la pression interne accumulée, mais une proportion reste dans l’anthéridium et sort plus lentement, sur plusieurs minutes.
Le résumé du paragraphe précédent suffit à vous donner une compréhension rapide des grandes caractéristiques du processus, mais il existe des variations dans les détails les plus fins d’une espèce à l’autre. La page DE LIBÉRATION & DE DISPERSION DES SPERMATOZOÏDES examine de plus près certaines des étapes chez quelques bryophytes. Le processus spermatozoïde-ovule a été étudié en profondeur chez un nombre relativement faible de bryophytes. Ainsi, les exemples donnés sur cette page peuvent ne pas expliquer les processus chez tous les bryophytes, mais vous verrez au moins certaines des variations connues ![]() .
.
Après la fécondation
Une fois qu’un ovule a été fécondé, le développement du sporophyte commence. L’œuf fécondé s’allonge et après quelques divisions cellulaires commence à se différencier. La partie inférieure devient généralement un pied qui pénètre dans le gamétophyte et ancre le sporophyte embryonnaire au gamétophyte. La tige se développera dans la capsule porteuse de spores (ainsi que la tige de support ou seta, chez les espèces chez lesquelles la capsule mature est traquée).
Les sporophytes dépendent au moins partiellement du gamétophyte pour leurs nutriments. Les cellules de transfert se développent à la limite sporophyte-gamétophyte chez la majorité des bryophytes, mais pas toutes. Ces cellules sont des cellules spécialisées qui permettent un transfert efficace des nutriments du gamétophyte au sporophyte. Chez les bryophytes où ils se trouvent, ils peuvent se former sur le gamétophyte, le sporophyte ou les deux. Ainsi, combiné à la possibilité d’aucune cellule de transfert, il existe quatre possibilités. Tous les hornworts ont des cellules de transfert et ils ne se forment que sur le gamétophyte. Trois des quatre possibilités se produisent dans les mousses. Dans la majorité des genres de mousses, les cellules de transfert se trouvent à la fois sur le gamétophyte et le sporophyte, bien qu’elles soient absentes dans la sphaigne et dans un petit nombre de genres de mousses, elles ne se trouvent que sur le sporophyte. Un exemple commun de ce dernier est le genre Polytrichum et ses proches parents. Dans les hépatiques, les quatre possibilités se produisent. Les hépatiques feuillus ont des cellules de transfert uniquement sur les sporophytes. Dans les hépatiques thalloses complexes, les cellules de transfert se trouvent à la fois sur le sporophyte et le gamétophyte. Dans les hépatiques thalloïdes simples, il existe des exemples des quatre possibilités.
La jonction gamétophyte-sporophyte a souvent une forme alambiquée et labyrinthique. Cela donne une plus grande surface (et donc plus de cellules de transfert) qu’une simple limite lisse et augmente ainsi la vitesse à laquelle les nutriments peuvent s’écouler vers le sporophyte ![]() .
.
Après la fécondation, l’archégonium se modifie en une gaine protectrice autour du jeune sporophyte. Il existe des différences significatives, tant au niveau de la structure que du développement, entre les sporophytes de l’armoise, de l’hépatique et de la mousse. Vous pouvez en savoir plus sur l’apparence extérieure en vous rendant dans la SECTION GROUPES DE BRYOPHYTES. Dans la SECTION DÉVELOPPEMENT DES SPOROPHYTES, vous trouverez des comptes rendus plus détaillés du développement des sporophytes et de leur structure interne.
Chez les mousses, les archégones se forment généralement en groupes. Dans de nombreux cas, une fois qu’un archégonium d’un tel groupe a été fécondé, les autres perdent la capacité d’être fécondés. Cela semble être causé par une hormone inhibitrice libérée par un archégonium fécondé. Dans de telles circonstances, un seul sporophyte peut se développer à partir de ce groupe archégonial. Cependant, dans certaines circonstances, plus d’un sporophyte peut se développer à partir d’un groupe archégonial. Un tel phénomène est appelé polysety. Cela peut être dû à la fécondation simultanée de deux archégones ou peut-être à la production d’une quantité trop faible d’hormone inhibitrice.
Voir aussi:
Liberation & dispersal of sperm
Vegetative Reproduction
Sexual vs Vegetative Reproduction
Leave a Reply